|
|
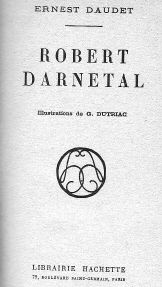 |
|
|
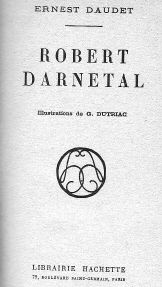 |
Je n'ai pas toujours vécu dans l'opulence.
Il y a cinquante quatre ans, quand je vins au monde, les Petites-Dalles étaient un pauvre hameau ignoré, perdu dans un repli de falaise, aux bords de l'Océan, entre Fécamp et Saint-Valery. C'est aujourd'hui une jolie station de bains, avec des hôtels et des villas.
Notre maison, construite en galet, couverte en chaume, était située sur une terrasse peu élevée et dominait la plage.
A cette époque, la route qui conduit aujourd'hui à la plage était obstruée à son extrémité par un monticule coupé à pic comme un mur, du côté de l'eau. On n'arrivait au galet qu'en passant par notre terrasse, au moyen d'un escalier, dont les marches avaient été taillées dans le rocher par un ouvrier de la contrée. Les habitants de la commune avaient droit à ce passage.
Par là descendaient les enfants et les femmes, s'en allant, à mer basse, chercher des crevettes et des crabes dans les rochers, ou les hommes chargés de filets et de lignes qu'ils allaient tendre au loin.
A leur retour, c'est aussi devant notre maison que chacun apportait sa capture. Les prises étaient examinées, estimées ensuite au plus juste prix, et confiées à l'ancien garde-côte, le vieux Marlorat, qui allait les vendre à Fécamp pour le compte des pêcheurs.
Vers quelque temps de mon enfance que ma mémoire me ramène, ce que je vois toujours, c'est le cadre pittoresque que je viens de décrire, et dans ce cadre, mon père raccommodant ses filets, en plein air, par les beaux matins d'été, ou durant les soirées d'automne, quand il pêchait le maquereau ou le hareng sur les côtes d'Irlande ou d'Ecosse, ma mère seule au foyer me berçant entre ses bras, et laissant quelquefois rouler une larme qui tombait de ses yeux sur les miens à demi-clos.
C'est ainsi que j'atteignis ma septième année. J'avais poussé bien portant et robuste, et mon père jugea que j'étais en âge de m'embarquer avec lui. Il fut donc résolu que je l'accompagnerais à la pêche au hareng. Après avoir longuement réfléchi et beaucoup hésité, il s'était rendu acquéreur d'une barque qui devait prendre à son bord cinq hommes d'équipage, lui et moi compris, et à l'aide de laquelle il allait, pour la première fois, tenter la fortune à ses risques et périls.
Un matin de septembre, nous allâmes entendre la messe à Sassetot, et le même jour, à midi, une charrette nous emmenait à Fécamp, où nous devions embarquer. J'étais assis sur les filets, à côté de ma mère qui m'embrassait à tout instant. Mon père marchait derrière nous, avec les trois matelots qu'il avait engagés pour l'expédition, et qui appartenaient aux Petites-Dalles. Vingt-quatre heures après, nous étions en mer, et six jours plus tard sur les côtes d'Irlande, où nous nous mîmes sur-le-champ à la besogne.
Dure vie que celle-là! Le soir, on tendait les filets; on les relevait plusieurs fois dans la nuit; Le jour venu, on allait dormir sur la paille, puis on vidait le poisson, on le rangeait dans les barils. En ma qualité de mousse, j'étais chargé de faire la cuisine de l'équipage. On devine comment je faisais mon apprentissage de cuisinier. Pauvres matelots! de quels ragouts étranges je les ai nourris pour mes débuts!
Cette année-là nous fûmes heureux, et au bout de deux semaines, nous rentrions à Fécamp. Nous n'y restâmes que trois jours, le temps de décharger, de repartir et aussi d'embrasser la chère mère que nous allâmes surprendre un matin, et qui fut bien heureuse de nous revoir. Pour mon apprentissage, nous eûmes dans cette saison trois courses successives et également fructueuses.
« Allons! petit, tu nous as porté bonheur, » me disait mon père, Hilaire Darnetal, en riant.
Je ne vous ai pas encore parlé de lui; il est temps cependant que je vous le présente. Figurez-vous un grand gars de quarante-six ans, aux membres vigoureux, blond et rose, avec des yeux bleus, portant toute sa barbe et pas de moustaches. Il avait longtemps servi à bord des navires de l'État, comme mousse pendant la Révolution, comme matelot sous l'empire, et de ce temps de batailles, ce qu'il avait gardé de plus vivace, c'était la haine passionnée de l'Anglais.
Grâce à Dieu, ces vieux ressentiments sont oubliés aujourd'hui; mais ils étaient alors dans toute leur force. Ce qui les aggravait pour les pêcheurs de la Manche, qui s'en allaient en expédition dans les mers anglaises, c'est que ces braves se heurtaient là à des règlements maritimes rigoureux jusqu'à l'arbitraire, contre lesquels j'ai vu mon père se défendre en une circonstance mémorable.
Un de ces règlements portait que si quelque bateau, se trouvant en péril sur les côtes britanniques, était secouru par un Anglais, il deviendrait, ainsi que sa cargaison, la propriété du sauveteur, à moins que le patron ne fut assez riche pour racheter son bien. Aussi, quand, au retour de nos pêches, nous passions devant les grands ports d'Angleterre, étions-nous sûrs d'être escortés par des embarcations qui veillaient sur nous, prêtes à nous porter secours au moindre accident et à tirer parti du plus petit accroc.
Or, un matin, c'était à la fin de notre troisième voyage de la saison, nous naviguions par une mer très calme entre Portsmouth et l'île de Wight quand la maladresse du matelot auquel mon père avait cédé le gouvernail, alla nous jeter sur des rochers à fleur d'eau. En un jour de tempête nous nous serions brisés; nous eu fûmes quittes pour une légère avarie.
Mais, tandis qu'on la réparait, une barque de Portsmouth, montée par six hommes, nous aborda, et l'un d'eux, mettant la main sur notre bateau, fit mine d'y monter, tandis que, pour nous rassurer, il nous disait en français:
«Soyez sans crainte, braves gens, nous venons à votre aide.»
A ce moment, je vis mon père changer de couleur, bondir sur une hache, et la brandissant d'un air terrible, s'élancer sur nos prétendus sauveurs, en criant:
«A bas les pattes ! ou je les fais sauter...
- Nous sommes des amis, baragouina l'Anglais interdit.
- Je n'ai que faire de votre amitié, répliqua mon père; si vous m'en croyez, passez au large. »
Son regard exprimait tant de froide résolution, que ceux auxquels il s'adressait s'éloignèrent sans mot dire.
Jean-Claude Michaux nous donne les précisions suivantes quant à ce roman:
L'édition Hachette de 1880 de Ernest Darnétal est illustrée de 81 vignettes dessinées sur bois par Sahib.
|
Au début du 3ème chapitre, l'action se déroule sur la plage des Petites-Dalles. La première gravure correspond bien aux falaises vues des Petites-Dalles en direction de la pointe de Saint-Pierre-en-Port. Curieusement, la gravure suivante, deux pages après, est inversée. |
|
|
Accès à la mer au XVIIIème et au début du XIXème siècle (hypothèse de Yves Robert et Jean-Claude Michaux):
Le héros du roman d'Ernest Daudet présente les Petites-Dalles dans sa jeunesse, c'est à dire dans la première moitié du XIXème siècle.
"Notre maison, construite en galet, couverte en chaume, était située sur une terrasse peu élevée et dominait la plage.
A cette époque, la route qui conduit aujourd'hui à la plage était obstruée à son extrémité par un monticule coupé à pic comme un mur, du côté de l'eau. On n'arrivait au galet qu'en passant par notre terrasse, au moyen d'un escalier, dont les marches avaient été taillées dans le rocher par un ouvrier de la contrée. Les habitants de la commune avaient droit à ce passage.
Par là descendaient les enfants et les femmes, s'en allant, à mer basse, chercher des crevettes et des crabes dans les rochers, ou les hommes chargés de filets et de lignes qu'ils allaient tendre au loin."
Pour comprendre cette description du bord de mer des Petites-Dalles, au début du XIXème Siècle, il faut se reporter au Mémoire Général Des Côtes maritime de la Normandie, établi au XVIIIème siècle, pendant la guerre avec l'Angleterre :
On a bordé le rivage de retranchements qui étaient absolument nécessaires pour défendre une grève assez spacieuse où l'on peut aborder à deux heures de flot, d'où il serait tres facile de pénétrer dans le vallon.
Au XVIIème et XIXème siècles, comme pendant la seconde guerre mondiale, un talus barrait la route (l'actuelle rue Joseph Heuzé), pour interdire l'accès à d'éventuels envahisseurs venus de la mer.
|
La rue principale étant bouchée, la population avait besoin d'un passage pour atteindre la mer. L'accès à la mer décrit par Ernest Daudet, pourrait bien être la sente, prenant à droite de la sente des douaniers, passant actuellement entre les villas: les Capucines, l'Epine, Brise-lames, d'un côté, l'Erable, le Vieux Puits, la Plage, de l'autre côté. Cette localisation semble confirmée par l'illustration de la première page de l'édition de 1880, sur laquelle les falaises figurent à l'arrière plan, derrière la maison, à gauche de la plage.
|
 |