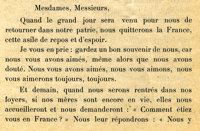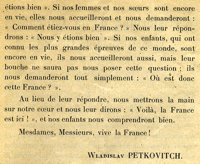Pendant la première
guerre mondiale, une colonie serbe était réfugiée
aux Petites-Dalles et logeait à l'Hôtel des Pavillons et à la villa Kermor.
Parmi ces réfugiés se trouvait Vladislav Petkovic Dis, célèbre poète serbe.
Le 26 août 1916, il participa avec Ernest Daudet à un concert organisé aux Petites-Dalles par la Croix-rouge française au cours duquel, il fit cette émouvante déclaration :
Mesdames, Messieurs,
Quand le grand jour sera venu pour nous de retourner dans notre patrie, nous quitterons la France, cet asile de repos et d'espoir.
Je vous en prie: gardez un bon souvenir de nous, car nous vous avons aimés, même alors que nous avons douté. Nous vous avons aimés, nous vous aimons, nous vous aimerons toujours, toujours.
Et demain, quand nous serons rentrés dans nos foyers, si nos mères sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont : « Comment étiez-vous en France? » Nous leur répondrons : « Nous y étions bien ». Si nos femmes et nos soeurs sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont « Comment étiez-vous en France ? » Nous leur répondrons « Nous y étions bien ». Si nos enfants, qui ont connu les plus grandes épreuves de ce monde, sont encore en vie, ils nous accueilleront aussi, mais leur bouche ne saura pas nous poser cette question ; ils nous demanderont tout simplement « Où est donc cette France ? ».
Au lieu de leur répondre, nous mettrons la main sur notre coeur et nous leur dirons : « Voilà, la France est ici ! », et nos enfants nous comprendront bien.
Mesdames, Messieurs, vive la France !
WLADISLAV PETKOVITCH.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D'après les documents que nous a adressés Mme Olivera Nedeljkovic, voici quelques précisions sur cette colonie serbe :
Les premiers réfugiés serbes sont arrivés aux Grandes-Dalles le 27 janvier 1916. Ils ont été 133.
La colonie a déménagé des Grandes-Dalles aux Petites-Dalles le 23 mai 1916 et s'est installée à l'Hôtel des Pavillons et à la Villa Kermor. Au mois d'août 1916, elle comptait 83 personnes, 23 femmes et 60 hommes.
La directrice était Mme Marguerite Pavlovitch, née Brulé, et le Directeur M. Dimitrié Pavlovitch, avocat, président du Club français de Nisch (Serbie).
Apparemment, il ne s'agissait pas de soldats blessés ou convalescents, mais essentiellement des représentants de professions libérales — avocats, médecins, ingénieurs — qui avaient fui leur pays envahi.
Mesdames, Messieurs,
Vous voudrez bien tout d'abord être assez indulgents pour excuser mon faible talent d'orateur et ma façon de m'exprimer en français.
Il est d'usage dans notre pays, en Serbie, d'ouvrir toute réunion par la bienvenue aux auditeurs, le « Salut aux assistants »« Posdrav Gostima », comme l'on dit en Serbie. — Soyez donc, Mesdames, Messieurs, les bienvenues parmi nous et c'est au nom de tous les membres de la colonie, composée de quelques avocats, docteurs, ingénieurs, etc., que je vous remercie de tout coeur d'être venu aussi nombreux à la petite fête que nous avons organisée et pour laquelle nous avons été gentiment aidés de quelques bonnes volontés. — Nous serons heureux si nous avons pu vous procurer un moment agréable, tout en songeant à nos chers et braves combattants, à nos blessés, à tous les frères d'armes françaises et serbes.
La France, pour nous Serbes, a toujours été une seconde patrie, tous nous l'avons toujours aimé et dans nos malheurs c'est une consolation pour nous que son accueil si noble et si généreux. — Merci à la France et à tous les Français pour tout ce que l'on fait pour adoucir notre exil, car nous sommes, ici, aussi bien qu'on peut l'être.
Ces tristes circonstances nous auront permis de mieux nous connaître et, après la guerre, après la victoire finale, les distances seront aplanies et entre nous, entre nos deux pays, subsisteront toujours des liens d’amitié et de fraternité plus resserrée. Déjà, en effet, la victoire se fait pressentir sur tous les points. À Salonique, ne sont-ils pas groupés, Français, Anglais, Russes, Italiens, Serbes, pour la victoire prochaine ?
Oui, certainement, bientôt nous retrouverons nos foyers, une Serbie agrandie, plus chère encore, grâce à tous les alliés, et notre reconnaissance restera à la France.
Avant de céder la parole à l’illustre conférencier, M. Ernest Daudet, je tiens à saluer au nom de tous mes compatriotes la présence à cette fête de M. le colonel Nénadovitch, officier de la Légion d’honneur, attaché à Son Altesse Royale le prince Alexandre de Serbie, qui nous fait le plaisir de représenter notre armée et la Légation Royale.
Le colonel Nénadovitch, dont nous sommes fiers, est un de ses héros, il a reçu sur le champ de bataille 42 blessures. C’est un brave dont je demanderai à mes compatriotes et à vous nos amis français, de saluer le nom de vos applaudissements.
Merci à la France, merci à vous tous, encore une fois !
Mesdames, Messieurs,
On m'a demandé de vous exposer l'objet de cette réunion. Je le ferai brièvement, car je suppose que vous êtes plus pressés de voir le spectacle qu'on a préparé pour vous, que désireux d'entendre une parole qui, fût-elle la plus éloquente que la mienne, ne saurait vous offrir l’attrait de ce qui vient du lointain, de ce que l'on entend pour la première fois. Le local où vous êtes réunis abritent, vous le savez, des réfugiés Serbes à qui la France s'est faite un devoir de donner l'hospitalité comme elle l'a donné aux réfugiés belges et de leur assurer jusqu'au jour où la victoire leur rouvrira la patrie d'où les a chassés une invasion criminelle.
Comme les Français des pays envahis, comme le vaillant peuple de Belgique, les réfugiés Serbes sont les victimes du plus effroyable désastre qui puisse atteindre une nation et la frapper dans sa vie, dans sa gloire ancestrale, dans ses biens, dans ses ambitions légitimes et dans ce que l'homme a de plus cher au monde : le pays natal.
Contre cette petite nation, Guillaume II, empereur d'Allemagne, bourreau de sang, et son ancien complice, l'astucieux et sénile François-Joseph, empereur d'Autriche-Hongrie, ont, à la faveur d'un prétexte calomnieusement invoqué, jeté à l'improviste leurs soldats les plus barbares, alors que l'armée serbe épuisée par de récentes victoires sur le Turc et sur le Bulgare n'avait pas eu le temps de se préparer à de nouveaux combats. En cette heure critique où les alliés ne pouvaient encore lui porter secours, tout a manqué à la Serbie, et tandis que le traître Ferdinand de Bulgarie prenait les armes contre elle, le roi de Grèce refusait de tenir les engagements qu'il avait contractés quelques mois avant en se liant à elle par un traité.
L'héroïsme de ses soldats ne pouvait en de telles circonstances la préserver de la défaite. Elle a été vaincue par le nombre et devant un ennemi coutumier des pires atrocités, ses habitants ont dû s'enfuir. Oh ! Cette fuite, quel drame poignant !!
Les chemins par lesquels elle s’est effectuée à travers les montagnes, se sont couverts, durant ces semaines tragiques, de blessés et de morts parmi lesquels on a compté des femmes, des enfants, des vieillards qui avaient succombé au froid, à la faim, aux plus effroyables privations.
Et ne croyez pas que dans ce terrible exode, parmi ces fugitifs lamentables, il y ait eu des privilégiés !
Riches et pauvres, gens de tout âge, de tout sexe, de toutes conditions, le vieux roi Pierre, son valeureux fils le prince Alexandre, son gouvernement, ses soldats, son clergé, ses sujets, les membres du corps diplomatique accrédité auprès de lui auront subi la même infortune, infortune si grande, si féconde en péripéties qu'on a pu dire que la retraite de Serbes constitue l'une des plus violentes tragédies qu’ait enregistrées l'histoire du monde. Ceux qui y ont survécu ont enfin trouvé des asiles dans les pays alliés, en France notamment, et c'est ainsi que nos Petites-Dalles ont été désignées pour recevoir quelques-uns de ces infortunés qui y ont été l'objet de la sympathie et de la compassion que méritaient leur malheur et la dignité de leur attitude.
Il est vrai qu'il constitue une élite intellectuelle, puisque tous ou presque tous exerçaient dans leur pays des professions libérales. De ce refuge où leurs existences matérielles est assurées, ils peuvent aussi suivre avec confiance les événements qui préparent la résurrection de leur pays et plus particulièrement de son armée. On avait pu la croire irrévocablement détruite et voici que grâce aux alliés elle est debout, équipée, forte de 150.000 hommes, prête à combattre à côté des soldats de l'Entente, a renouvelé ses anciens exploits, à vaincre ou à mourir pour la délivrance de la patrie.
Il y a quelques jours, mon ami, M. Auguste Boppe, ministre de France auprès du gouvernement serbe installé à Corfou, m'écrivait :
« Vous avez appris de quelle admirable façon les Serbes se sont réunis à Corfou. Ceux qui les ont connus à Scutari ne pouvaient les reconnaître quand ils sont partis pour Salonique. Quels soldats admirables ! »
C'est pour vous, Messieurs les réfugiés, que j'ai cité ce fragment de lettres.
Il ranimerait vos espérances, votre foi dans l'avenir de votre pays si elle avait besoin d'être ranimée. Que du moins il contribue à cicatriser les plaies de vos âmes meurtries et les emplisse d'un légitime orgueil !
Je vous ai dit, Mesdames et Messieurs, que la vie matérielle de nos réfugiés était assurée, c'est-à-dire le nécessaire. Toutefois, ceux qui les approchent avaient cru s'apercevoir qu'il en était parmi eux de plus éprouvés que d'autres, à qui manquait un peu de ce superflu dont les habitudes d'une existence confortable font presque une nécessité.
De là, l'idée touchante dont l'honneur revient à M. le Sous-Préfet d'Yvetot et à Mme Piettre d'organiser cette réunion dont nos réfugiés seraient les protagonistes et dont le profit leur vaudrait un peu plus de bien-être. Mais quand on a sollicité leur concours en leur disant pourquoi, ils ont déclaré qu'il le donnerait avec joie, mais en témoignage de gratitude envers la France et au bénéfice de la Croix-Rouge française.
— Quant à nous, ont-ils dit, nous n'avons besoin de rien, les moins malheureux s'étant entendus entre eux pour venir en aide à ceux qui le sont davantage.
C'était un beau geste, Mesdames et Messieurs, un révélateur de ce que peut contenir de noblesse et de dignité l’âme des proscrits quand ils souffrent pour une grande cause. Il a bien fallu s'y soumettre.
— Soit, au bénéfice de la Croix-Rouge française, a-t-on répondu, mais aussi à celui de la Croix-Rouge serbe.
Voilà mes chers compatriotes, toute la genèse de la réunion d'aujourd'hui.
Elle ne me laisse rien à ajouter. Si j'étais ainsi à la table d'un festin, je lèverais mon verre à la résurrection victorieuse de la Serbie. Associez-vous à ce toast idéal en applaudissant au spectacle qui va vous être donné.
Je les dédie à toi, mon cher Bane, ces pages sincèrement écrites, à toi qui as su donner ta belle jeunesse à la patrie, que tu aimais en vrais patriotes.
C’était, dans une rue non loin du grand marché de Belgrade, une maison à deux étages, nouvellement construite, dont la façade, on rembrunie par le soleil qui l’inondait les clairs jours d’été et fatiguée de supporter cette chaleur, se résigner à regarder silencieusement les eaux agitées du Danube et l’immense plaine de Banat qui s’étend à perte de vue.
Dans la journée c’était par là le tapage de tout le monde qui va au marché pour vendre ou pour acheter. Le soir venu, le bruit cessait et la rue reprenait son aspect tranquille, interrompue de temps à autre, par le coassement des grenouilles venant du fleuve et cette musique endormait et réveillait les habitants de tout ce quartier.
Tous les soirs, est toujours à la même heure, la porte d’une chambre de l’appartement du premier de cette maison s’ouvrait et alors entraient des jeunes gens qui, à en juger par leur façon, y étaient chez eux ou avaient bien l’habitude d’y venir.
Le refuge de ces jeunes gens était bien modestement meublé : une table au milieu, quatre chaises autour, un divan à côté, l’étagère à livres contre le mur, quelques tableaux d’auteurs favoris accrochés par-ci, par-là, sans oublier les vrais amis de ces jeunes gens : la lampe à abat-jour, posée sur la table, mignonne et docile, et le poêle écossais, le bon compagnon des longues nuits d’hiver.
Le jeune homme auquel ce petit coin servait de cabinet de travail, avait comme les autres du reste, un culte d’amitié pour cet endroit qui avait tant entendu les raisonnements et les projets de ses visiteurs, riches en idée : celles-ci étaient nombreuses comme les rayons se dirigeant vers leurs jeunes visages du milieu de la lampe sous laquelle il venait s’abriter tous les soirs.
C’était à l’époque où ils préparaient leurs examens de baccalauréat.
Les belles nuits de mai, auxquelles Alfred de Musset doit ses plus belles poésies, douces et bourdonnantes d’une légère tristesse et pleines d’étoiles dont l’énigmatique frissonnement charmait le berger d’Alphonse Daudet qui en cherchait naïvement la cause, réveillaient chez les quatre jeunes hommes, courbés sur leurs livres, l’image de leur combinaison et de leurs rêves : Paris. Le Paris chevaleresque et noble de jadis et le Paris actif et intellectuel d’aujourd’hui ! Le Paris d’Alexandre Dumas père, et celui d’Anatole France !
Cela les faisait travailler plus énergiquement comme les examens approchaient.
Aucun des deux n’entendait, dans les vagues murmures du fleuve d’en bas, les avertissements fatals des événements proches, qui ont fait que les quatre jeunes hommes, les examens passés, au lieu d’aller réaliser leurs idées, se sont dispersé chacun de leur côté, pour servir de leur mieux la patrie en danger.
Il y avait un amour plus fort que celui de ce petit refuge, c’était l’amour de la patrie menacée, de la patrie ayant besoin de tous ses fils, pour résister à l’adversaire bien plus nombreux et beaucoup mieux préparé.
Le petit coin adorait et toutes ces choses, si étroitement liés à leur existence d’alors, ont été abandonnés et subitement, sans adieu, même sans un amical sourire.
Ne vous fâchez pas, pauvre mignonne chose, vous gardez le plus cher de ce qu’ils ont pu vous donner : leur belle jeunesse de 20 ans, souriante et fraîche. Gardez-la bien, ils viendront vous la demander un jour, telle qu’ils vous l’ont laissée. Gardez la bien, pauvres mignonnes choses.
A Marseille, au moment de monter dans le train qui devait m’amener à Paris, je me suis rappelé, — étant un de ces quatre jeunes hommes dont l’un, fils d’un de nos auteurs dramatiques les plus éminents, est tombé au champ d’honneur quelques jours avant le commencement de notre pèlerinage fatal, et dont les deux autres sont avec nous dans le pays dont la pensée obsédait leur tendre jeunesse, — je me suis rappelé, dis-je, ce récent passé beau et douloureux.
— Le lendemain matin de ce jour-là, dans un hôtel de la rue de Rivoli, je ravivais de nouveau les souvenirs de cette vie, jeune et attrayante, passée dans mon beau pays lointain et martyr.
Les rayons tachés du soleil et de décembre entraient anxieusement dans la chambre et s’amusaient à caresser le maigre visage du nouveau venu. C’était sa façon de souhaiter la bienvenue à ce jeune malheureux.
Je m’approchais de la fenêtre et je vis le soleil de Paris, un petit trou clair creusé dans le ciel nuageux, dont les faibles rayons paraissaient être les larmes d’une douleur silencieuse et discrète.
Une fois dans la rue, marchant du pas incertain de l’étranger dans la ville inconnue, j’ai éprouvé le même sentiment.
En regardant les femmes en deuil, dont les visages portaient des traces de souffrance, les hommes empressés les taciturnes, les maisons tristes et mornes, la rivière chantant quelque chose d’incompréhensible, qui faisait pleurer, je sentis la nostalgie : car j’ai vu dans les tristes visages de ces femmes et de ces hommes, les visages de nos mères et de nos soeurs, de nos pères et de nos frères laissés là-bas, dans le pays souffrant comme celui-ci ; dans ces maisons languissantes le reflet de nos foyers abandonnés, dans la Seine coulant doucement notre Save autrefois coquette, tranquille et taciturne ; dans le jardin du Luxembourg, ce rendez-vous de jeunesse, dont les arbres grelottaient de froid, notre Calimegdane qui en ce moment-là gémissait lui aussi dans sa jeunesse gaie et insouciante.
Mais dans cette atmosphère où tout était en deuil, où tout peut régler mort pour ce géant de Paris et le beau pays de France, il y avait de l’énergie et de la persistance.
Je ressentis un amour de cet endroit, analogue à celui du pays qui cache ce qui m’est le plus cher ; je sentis que je l’aimais et que je l’aimerai.
En rentrant à l’hôtel, j’ai caressé amicalement des yeux les eaux de la Seine et regardé tendrement de la terrasse du parc des Tuileries, le petit soleil de Paris qui attendait patiemment le jour où ses vifs rayons nous annonceront brillamment la victoire.
— J’ai compris la France, je l’aimais et je l’aime toujours plus chaque jour.
Discours de M. Wladislav Petkovitch
Traduit en français et lu par M. Bora Martinatz, étudiant en droit.
Mesdames, Messieurs,
Je vous prie d’être ce que vous êtes toujours : indulgents envers les faibles, bienveillants envers ceux qui n’ont pas d’expérience. Si je commets des fautes dans ma causerie, ce ne sera pas la peine de me corriger, le temps le fera. Car je suis le fils, l’humble fils de ce peuple, qui est embrassé par l’héroïsme et la douleur. Je suis le fils faible de mon peuple et les faibles peuvent devenir forts seulement avec le temps.
Je vous prie de me permettre de vous remercier et comme Serbe et comme membre de la présente Colonie, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous ferez pour nous. Et si je n’y réussissais pas non plus, j’en assume sur moi toute la responsabilité et c’est seulement à moi que vous devrez adresser vos reproches.
Excusez-moi, Messieurs, de me présenter si embarrassé aujourd’hui devant vous, et ne vous étonnez pas si je suis plutôt triste que sérieux.
Si je lève parfois la tête, je vous en prie, comprenez-moi ; ce ne sera pas de gaîté, mais de fierté, de fierté d’être chez vous, d’être avec vous. Car le temps de mon bonheur est disparu avec la liberté du peuple Serbe. Nous sommes sans patrie.
Et maintenant, Messieurs, si cela vous plaît, je vous invite à repasser avec moi quelques pages de l’histoire du peuple Serbe, histoire qui n’est pas encore finie et qui n’a pas encore son nom.
Le 5 octobre 1915, l’année dernière, en Serbie, n’a pas été un jour comme les autres. Sitôt le soleil couché, un infernal tonnerre s’entendait quoique la soirée fut calme et le ciel serein. C’était le salut que les deux mille canons de Mackensen adressaient au soleil couchant. Et l’orgie sanglante commençait.
Cinquante-deux heures sans cesser les canons ont tonné. Dans les villes et les villages, aux environs, les fenêtres ont tremblé pendant deux nuits et demie et les enfants ont pleuré.
Et quand il sembla au généralissime teuton que la première partie de son programme sanguinaire était réalisée et que le terrain était nettoyé, la troisième nuit, vers minuit, il commença à jeter par-dessus le Danube ses troupes.
Mais comme il a été surpris ! Dans ce fracas et le tonnerre, le ciel était resté calme, le bleu Danube était resté calme ; mais le soldat serbe étaie resté calme aussi : il se taisait et attendait tranquillement dans sa tranchée. J’ai été alors sur le Danube, vers la ville de Pozarevatz, comme correspondant militaire. J’ai toujours connu notre soldat, ce qu’il est avant le combat et ce qu’il est pendant le combat.
Cette fois-ci, comme d’habitude avant le combat, il était calme ; il n’avait pas peur de l’Allemand, quoiqu’il le sût redoutable.
Au contraire, il était gai d’avoir l’occasion de l’affronter : « Combattons jusqu’au bout et advienne ce que pourra ! » Et voilà comment ils se sont rencontrés avec les Boches.
Quand la nuit du 7 octobre sur Doubravitza (l’endroit qui se trouve au bord du Danube), les quatre bataillons du Vardar on fait en seize heures sept attaques et jeter les Allemands dans le Danube. Et au premier crépuscule, il ne restait aucun Allemand près de Doubravitza, mais il ne restait aucun Serbe non plus.
De pareilles luttes ont obligé Mackensen à demander le septième jour de son offensive des secours, si les Bulgares n’attaquaient pas immédiatement la Serbie.
Et le félon a voulu rester toujours fidèle à la félonie et la Bulgarie nous attaqua le 17 octobre.
Et il arriva ainsi que la surprise qui était tombée sur la tête de Pathoren, généralissime préféré de François-Joseph, évita Mackensen à qui le soldat serbe pourtant préparait aussi de grandes surprises. Et lui, le soldat serbe, qui a porté toujours la couronne de la victoire sur sa tête fière, a reçu en pleine poitrine des défaites si grandes et de si grands malheurs, que jamais jusqu’à présent ni l’homme ni Dieu n’en ont vu de semblables.
Arrêtons-nous ici.
Pendant quatre jours, jusqu’au 17 octobre, les troupes qui étaient sur le Danube ignoraient leurs nouveaux ennemis. Les combats avaient déjà eu lieu sur notre territoire, et quoique les troupes fussent en petit nombre, ils résistaient tout de même à l’ennemi.
Mais le cinquième jour, toutes les troupes apprirent la nouvelle non seulement de l’attaque bulgare, mais aussi de la chute d’Uscub, Vranjé et d’autres villes. La débâcle nous survolait ; on battait en retraite ; les luttes contre les Allemands avaient cessé, le terrain se perdait, morceau après morceau, comme dans un déluge. Et chaque jour les malheurs augmentaient. L’enfer descendait sur la terre et le peuple Serbe y descendait de plus en plus, et quand on arriva à Durazzo, le calice était vidé jusqu’à la lie.
Et voilà maintenant quelques images qui sont restées vivantes dans ma mémoire, de cette tragique retraite :
Nous voilà à la montagne de Merdare. Nous n’avons aucun secours, aucune ambulance.
C’était la nuit, il faisait froid, il faisait du brouillard. Le capitaine était assis, la tête dans les mains, et les soldats dispersés. Tout d’un coup un soldat l’aborda : « Capitaine, je ne peux plus me battre ». « Pourquoi » ? Lui demanda l’officier en levant la tête. « Si j’étais sur de tomber mort, cela irait bien ! Mais si j’étais blessé, alors quoi ? Vous n’ordonnerez sûrement pas qu’on me tue ; du reste personne ne voudra me tuer », ajouta le soldat comme réfléchissant en lui-même. Tous se taisent. L’officier, la tête levée haut, regarde non le soldat, mais vers quelque part au loin dans la profonde nuit qui était déjà tombée sur la Serbie.
Nous voilà à Kossovo. Les équipages militaires, traînés par les boeufs, marchent encore. Où ? Les troupes fatiguées et épuisées marchent encore. Mais où ?
Nous voyons quelques garçons de 15-18 ans retournant dans leurs foyers que l’ennemi a déjà occupés. Ils retournent tiraillés par la faim. Ils sont allés quelque part, n’importe où, en avant, pour ne pas tomber seulement aux mains de l’ennemi, et maintenant ils retournent. Les voilà qu’ils abandonnent en ce moment la route et marche à travers une prairie, leurs doigts dans la bouche. Tout cela nous paraît ordinaire. Mais tout d’un coup, on voit le fleuve Lab comme se remuer : les garçons y disparurent, l’eau les avait engloutis. « Ah ! » criaient les uns. « Ah ! mon Dieu ! » criaient les autres. Mais s’ils nous avaient demandé un morceau de pain ! Et les boeufs, les têtes courbées sous les jougs, traînaient les chariots au bruit grinçant des roues.
Nous voilà à Zljeb, aux portes du Monténégro, ce pays qui n’est couvert que par des roches. On traverse encore des montagnes par des chemins de chèvres. Deux garçons y marchent. Le jeune, âgé de 14 ans au plus, mène un cheval. L’aîné, âgé de 16 ans environ, tenait une femme montée sur le cheval est liée à la selle. Ces garçons, ce sont ses fils. Leur mère ne peut plus marcher. Est-elle fatiguée ? Non ! non ! Elle n’est pas fatiguée, elle est morte, morte en route. Les enfants la mènent jusqu’au premier village ou plutôt jusqu’au premier morceau de terre pour l’y ensevelir.
Plus loin, dans un creux des roches, était assis un soldat serbe. Son visage était si convulsé qu’on eût dit qu’il était déjà une fois dans le tombeau. Sa bouche était ouverte. Dans la main gauche il serrait quelque chose de noir. Est-ce un morceau de terre ? Je m’approche davantage. Tiens ! du chocolat. Quelqu’un qui avait encore un peu de coeur lui a donné par pitié ce morceau de chocolat, au dernier moment. Mais trop tard ! L’éternité séparait déjà sa main de sa bouche.
Nous sommes à Scutari. Dans une rue, quatre soldats marchent, leur visage est noir de poussière, on dirait quatre fantômes. Chacun d’eux porte un morceau de pain blanc, ils le portent aussi tendrement qu’une mère qui porte son enfant. J’arrêtais l’un d’eux : « Est-ce que tu vends du pain mon vieux ? » Il me regarda d’abord doucement et puis ajouta : « Non, Monsieur, je ne le vends pas, il y a un mois que je n’en ai pas vu et maintenant le vendre. Ah ! Non ! Je l’ai embrassé sept fois, Monsieur, et je l’embrasserai encore ». Pieusement il le porta à sa bouche et l’embrassa.
Mes yeux se remplirent de larmes. Il me regarda de nouveau et je sentis que quelqu’un me bénissait.
Voilà encore un exemple, vous l’avez ici devant vos yeux : c’est notre souverain, notre bon roi Pierre, qui a traversé toute l’Albanie en chariot de boeufs.
Mais, assez ! Mesdames, Messieurs. Laissons l’Albanie et le Monténégro, laissons la Serbie qui repose à l’ombre des tristes saules, et ajoutons encore quelques mots. A la fin de l’année dernière et au commencement de cette année, les bateaux, les uns après les autres, atteignaient les côtes françaises. Ils apportaient avec eux les impuissants débris du libre peuple Serbe. Mais ces impuissants débris se remirent promptement devant le coeur français qui battait si ardemment pour nous ; devant l’âme française qui nous réchauffait par sa bonté et sa bienveillance, par toute sa bonté et toute sa bienveillance.
Et ainsi le sort a donné à la France, pays de liberté, un nouveau rôle : celui de recevoir chez elle un peuple qui est tombé pour la liberté, mais qui par la victoire de la France, de la Russie et de l’Angleterre, la conquerra de nouveau. Et vous, Français, vous nous avez ouvert largement vos portes. Nous étions abattus, vous nous avez remontés. Nous étions dans le désespoir, vous nous l’avez écarté. Nous avions perdu la foi et en l’homme et en Dieu ; chez vous, nous l’avons retrouvée.
Dans votre complaisance, vous n’aviez pas de limites, si ce n’est seulement la question d’améliorer notre sort. Les meilleurs exemples en sont les colonies Serbes qui se sont dispersées dans toute la France.
Mais je ne veux pas abuser plus de votre attention, aussi ne vous parlerai-je pas de cette Colonie aux Petites-Dalles et ne vous dirai-je pas à quel point nous nous y trouvons bien !
Mais je dois mentionner que vous nous avez permis de donner ce concert, que vous nous avez permis ce dont vous vous privez vous-même.
Je dois dire aussi que la couronne de tout cela, c’est la présidence de M. le préfet de Rouen qui, malheureusement empêché d’y assister personnellement, est remplacé aujourd’hui par l’honorable M. Piettre, sous-préfet d’Yvetot.
De même, l’honneur de tout cela c’est la présence de M. Ernest Daudet, le digne frère de son illustre frère, qui préside aussi le concours particulier à ce concert.
Remercions aussi tous ceux qui ont bien voulu nous prêter leur gracieux concours. Tout cela, c’est la grâce et la musique.
Merci à tous ceux qui ont voulu nous faire l’honneur de leur présence. Merci à tous !
Mesdames, Messieurs,
Quand le grand jour sera venu pour nous de retourner dans notre patrie, nous quitterons la France, cet asile de repos et d'espoir.
Je vous en prie : gardez un bon souvenir de nous, car nous vous avons aimés, même alors que nous avons douté. Nous vous avons aimés, nous vous aimons, nous vous aimerons toujours, toujours.
Et demain, quand nous serons rentrés dans nos foyers, si nos mères sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont : « Comment étiez-vous en France? » Nous leur répondrons : « Nous y étions bien ». Si nos femmes et nos soeurs sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont « Comment étiez-vous eu France ? » Nous leur répondrons « Nous y étions bien ». Si nos enfants, qui ont connu les plus grandes épreuves de ce monde, sont encore en vie, ils nous accueilleront aussi, mais leur bouche ne saura pas nous poser cette question ; ils nous demanderont tout simplement « Où et donc cette France ? ».
Au lieu de leur répondre, nous mettrons la main sur notre coeur et nous leur dirons : « Voilà, la France est ici ! », et nos enfants nous comprendront bien.
Mesdames, Messieurs, vive la France !
Haut de page
Venir en France et la connaître, c’était le rêve de nous tous. Et ce qui n’était pas possible à beaucoup d’entre nous pendant la paix, nous est destiné pendant la guerre, au moment de nos plus grands malheurs nationaux et particuliers.
Pour l’avenir de nos familles restées dans nos maisons, avec nos biens, nous partîmes nombreux pour fuir l’invasion, loin de l’ennemi commun ; mais arriver en France ceux d’entre nous, seulement, qui eurent la chance de résister aux souffrances de toutes sortes : faim, froid, fatigue, endurées en Albanie, et ceux qui purent se défendre des attaques des Albanais.
Nous sommes maintenant dispersés par groupes plus ou moins nombreux dans différents points de la France, notre seconde patrie, où nous sommes reçus aussi bien qu’il est possible de l’être et il est bien certain que nous ici, aux Petites-Dalles, le somme mieux encore que partout ailleurs.
Ce qu’on fait pour nous et la façon dont le font Monsieur le Sous-Préfet d’Yvetot et madame Piettre, représentants du Gouvernement Français, ainsi que Monsieur Certain, maire de Sassetot, nous obligent pour toute notre vie et nous ne les oublierons jamais.
La générosité du peuple français sera racontée, chez nous, de génération en génération.
Les premiers réfugiés serbes sont arrivés dans cette colonie, aux Grandes-Dalles, le 27 janvier 1916 (n. s.), le jour de Saint-Sava Serbe et, de ce jour jusqu’à aujourd’hui, nous fûmes 133. Aujourd’hui, la colonie compte 83 personnes, dont 23 dames et 60 messieurs.
La colonie a déménagé des Grandes-Dalles aux Petites-Dalles le 23 mai 1916, installée à l’hôtel des Pavillons et à la villa Kermor, d’une façon telle que l’on ne croirait pas à une colonie de réfugiés. Accueillis chaque jour comme de bon et vieux amis, nous avons pu nous ressaisir et préparer un concert au profit de la Croix-Rouge Française et Serbe.
Le concert qui a eu lieu le 24 août, à 3 heures, a eu un tel succès qu’il a dû être redonné le même soir à 9 heures. La recette totale des deux concerts et de 1.384,80 fr., dont une somme de 1000 fr. est remise à Monsieur Piettre pour envoyer 500 fr. au général Sarrail, à Salonique, pour la Croix-Rouge Serbe et 500 fr. pour la Croix-Rouge Française à Yvetot.
A cette occasion, au nom des membres de la colonie, je remercie tous les auditeurs et plus particulièrement M. Ernest Daudet pour son intéressante causerie pour laquelle cette brochure est imprimée, ainsi que les autres personnes qui ont pris part au concert, notamment Mademoiselle Piettre qui en a organisé une grande partie et a fait beaucoup pour son succès, ainsi que Mesdemoislles Giron, Nicole Anckier, Duval, Leroyer, Monsieur Francin, Mesdemoiselles Schaeffer, Bredaut qui ont bien voulu prêter leur concours.
De même, au nom des membres de la colonie, je remercie Monsieur le Préfet de la Seine-Inférieure et Madame Morain qui ne nous oublient pas quoique n’étant pas tout près de nous, Monsieur le Sous-Préfet d’Yvetot, Madame et Mademoiselle Piettre, qui viennent nous voir journellement et font pour nous tout ce qui est possible de faire, Monsieur et Madame Certain, Monsieur Bourdon, qui s’occupent de la colonie et s’empressent toujours pour nous être agréables.
Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion sans remercier :
M. Alfred Morain, Préfet de la Seine-Inférieure ; Madame et M. Piettre, Sous-Préfet Yvetot ; M. H.-O. Beatty, directeur général de l’American Relief Clearing Hause (5, rue François-Ier, à Paris) ; M. Lepicard, maire de Canouville ; M. Leconte, représentant de la Bénédictine de Fécamp ; M. Pesquet, percepteur à Lillebonne ; Mme Greulich ; M. Cochaux, de Paris, dont les dons en argent comptant font une somme de 700 francs, qui est distribuée aux réfugiés de la Colonie les plus nécessiteux par M. Certain, maire, ou par le directeur de la Colonie.
L’American Relief Clearing Hause et son directeur général M. H.-O. Beatty, par l’intermédiaire duquel nous recevons des nobles Américains des dons en vêtements, linge, chaussures, etc., pour dames, messieurs et enfants, et dont, par Madame Piettre, nous avons, jusqu’à présent, reçu 2.393 articles, distribué 1.830 articles ; il reste à distribuer encore 563.
M. Bourdon, le directeur d’Ecole ; Mlle S. Dutot, directrice d’Ecole ; Mlle Fautrat, institutrice ; Mlle A. Delettre, institutrice, qui, pendant plusieurs mois, ont donné des leçons de français aux membres de la colonie.
Les rédactions du Temps, du Journal des Débats, du Figaro, du Matin, du Journal, de l’Illustration, des Annales Politiques et Littéraires, de la Femme chez elle, qui envoient régulièrement leurs journaux gratuitement.
Les éditeurs de musique : MM. Heugel, Choudens, Max Eschig, Marcel Labbé, Enoch et Cie, qui ont envoyé des partitions.
Vive la Serbie, notre Patrie !
Vive la France, notre seconde patrie !
Haut de page

Parmi ces réfugiés se trouvait Vladislav Petkovic Dis, célèbre poète serbe.
Le 26 août 1916, il participa avec Ernest Daudet à un concert organisé aux Petites-Dalles par la Croix-rouge française au cours duquel, il fit cette émouvante déclaration :
Mesdames, Messieurs,
Quand le grand jour sera venu pour nous de retourner dans notre patrie, nous quitterons la France, cet asile de repos et d'espoir.
Je vous en prie: gardez un bon souvenir de nous, car nous vous avons aimés, même alors que nous avons douté. Nous vous avons aimés, nous vous aimons, nous vous aimerons toujours, toujours.
Et demain, quand nous serons rentrés dans nos foyers, si nos mères sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont : « Comment étiez-vous en France? » Nous leur répondrons : « Nous y étions bien ». Si nos femmes et nos soeurs sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont « Comment étiez-vous en France ? » Nous leur répondrons « Nous y étions bien ». Si nos enfants, qui ont connu les plus grandes épreuves de ce monde, sont encore en vie, ils nous accueilleront aussi, mais leur bouche ne saura pas nous poser cette question ; ils nous demanderont tout simplement « Où est donc cette France ? ».
Au lieu de leur répondre, nous mettrons la main sur notre coeur et nous leur dirons : « Voilà, la France est ici ! », et nos enfants nous comprendront bien.
Mesdames, Messieurs, vive la France !
WLADISLAV PETKOVITCH.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Jean-Claude Michaux nous donne les précisions suivantes quant à cette colonie serbe des Petites-Dalles :
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
A noter que Monsieur Certain dont il est question ci-dessus était à l'époque le maire de Sassetot.
D'après les documents que nous a adressés Mme Olivera Nedeljkovic, voici quelques précisions sur cette colonie serbe :
Les premiers réfugiés serbes sont arrivés aux Grandes-Dalles le 27 janvier 1916. Ils ont été 133.
La colonie a déménagé des Grandes-Dalles aux Petites-Dalles le 23 mai 1916 et s'est installée à l'Hôtel des Pavillons et à la Villa Kermor. Au mois d'août 1916, elle comptait 83 personnes, 23 femmes et 60 hommes.
La directrice était Mme Marguerite Pavlovitch, née Brulé, et le Directeur M. Dimitrié Pavlovitch, avocat, président du Club français de Nisch (Serbie).
Apparemment, il ne s'agissait pas de soldats blessés ou convalescents, mais essentiellement des représentants de professions libérales — avocats, médecins, ingénieurs — qui avaient fui leur pays envahi.
Lors de ce concert donné le 26 août 1916 aux
Petites-Dalles, il y eut plusieurs allocutions :
|
 |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Bienvenue aux auditeurs
Mesdames, Messieurs,
Vous voudrez bien tout d'abord être assez indulgents pour excuser mon faible talent d'orateur et ma façon de m'exprimer en français.
Il est d'usage dans notre pays, en Serbie, d'ouvrir toute réunion par la bienvenue aux auditeurs, le « Salut aux assistants »« Posdrav Gostima », comme l'on dit en Serbie. — Soyez donc, Mesdames, Messieurs, les bienvenues parmi nous et c'est au nom de tous les membres de la colonie, composée de quelques avocats, docteurs, ingénieurs, etc., que je vous remercie de tout coeur d'être venu aussi nombreux à la petite fête que nous avons organisée et pour laquelle nous avons été gentiment aidés de quelques bonnes volontés. — Nous serons heureux si nous avons pu vous procurer un moment agréable, tout en songeant à nos chers et braves combattants, à nos blessés, à tous les frères d'armes françaises et serbes.
La France, pour nous Serbes, a toujours été une seconde patrie, tous nous l'avons toujours aimé et dans nos malheurs c'est une consolation pour nous que son accueil si noble et si généreux. — Merci à la France et à tous les Français pour tout ce que l'on fait pour adoucir notre exil, car nous sommes, ici, aussi bien qu'on peut l'être.
Ces tristes circonstances nous auront permis de mieux nous connaître et, après la guerre, après la victoire finale, les distances seront aplanies et entre nous, entre nos deux pays, subsisteront toujours des liens d’amitié et de fraternité plus resserrée. Déjà, en effet, la victoire se fait pressentir sur tous les points. À Salonique, ne sont-ils pas groupés, Français, Anglais, Russes, Italiens, Serbes, pour la victoire prochaine ?
Oui, certainement, bientôt nous retrouverons nos foyers, une Serbie agrandie, plus chère encore, grâce à tous les alliés, et notre reconnaissance restera à la France.
Avant de céder la parole à l’illustre conférencier, M. Ernest Daudet, je tiens à saluer au nom de tous mes compatriotes la présence à cette fête de M. le colonel Nénadovitch, officier de la Légion d’honneur, attaché à Son Altesse Royale le prince Alexandre de Serbie, qui nous fait le plaisir de représenter notre armée et la Légation Royale.
Le colonel Nénadovitch, dont nous sommes fiers, est un de ses héros, il a reçu sur le champ de bataille 42 blessures. C’est un brave dont je demanderai à mes compatriotes et à vous nos amis français, de saluer le nom de vos applaudissements.
Merci à la France, merci à vous tous, encore une fois !
Dimitrié Pavlovitch
Avocat,
Président du Club français à Nisch (Serbie)
Avocat,
Président du Club français à Nisch (Serbie)
Causerie de M. Ernest Daudet
Mesdames, Messieurs,
On m'a demandé de vous exposer l'objet de cette réunion. Je le ferai brièvement, car je suppose que vous êtes plus pressés de voir le spectacle qu'on a préparé pour vous, que désireux d'entendre une parole qui, fût-elle la plus éloquente que la mienne, ne saurait vous offrir l’attrait de ce qui vient du lointain, de ce que l'on entend pour la première fois. Le local où vous êtes réunis abritent, vous le savez, des réfugiés Serbes à qui la France s'est faite un devoir de donner l'hospitalité comme elle l'a donné aux réfugiés belges et de leur assurer jusqu'au jour où la victoire leur rouvrira la patrie d'où les a chassés une invasion criminelle.
Comme les Français des pays envahis, comme le vaillant peuple de Belgique, les réfugiés Serbes sont les victimes du plus effroyable désastre qui puisse atteindre une nation et la frapper dans sa vie, dans sa gloire ancestrale, dans ses biens, dans ses ambitions légitimes et dans ce que l'homme a de plus cher au monde : le pays natal.
Contre cette petite nation, Guillaume II, empereur d'Allemagne, bourreau de sang, et son ancien complice, l'astucieux et sénile François-Joseph, empereur d'Autriche-Hongrie, ont, à la faveur d'un prétexte calomnieusement invoqué, jeté à l'improviste leurs soldats les plus barbares, alors que l'armée serbe épuisée par de récentes victoires sur le Turc et sur le Bulgare n'avait pas eu le temps de se préparer à de nouveaux combats. En cette heure critique où les alliés ne pouvaient encore lui porter secours, tout a manqué à la Serbie, et tandis que le traître Ferdinand de Bulgarie prenait les armes contre elle, le roi de Grèce refusait de tenir les engagements qu'il avait contractés quelques mois avant en se liant à elle par un traité.
L'héroïsme de ses soldats ne pouvait en de telles circonstances la préserver de la défaite. Elle a été vaincue par le nombre et devant un ennemi coutumier des pires atrocités, ses habitants ont dû s'enfuir. Oh ! Cette fuite, quel drame poignant !!
Les chemins par lesquels elle s’est effectuée à travers les montagnes, se sont couverts, durant ces semaines tragiques, de blessés et de morts parmi lesquels on a compté des femmes, des enfants, des vieillards qui avaient succombé au froid, à la faim, aux plus effroyables privations.
Et ne croyez pas que dans ce terrible exode, parmi ces fugitifs lamentables, il y ait eu des privilégiés !
Riches et pauvres, gens de tout âge, de tout sexe, de toutes conditions, le vieux roi Pierre, son valeureux fils le prince Alexandre, son gouvernement, ses soldats, son clergé, ses sujets, les membres du corps diplomatique accrédité auprès de lui auront subi la même infortune, infortune si grande, si féconde en péripéties qu'on a pu dire que la retraite de Serbes constitue l'une des plus violentes tragédies qu’ait enregistrées l'histoire du monde. Ceux qui y ont survécu ont enfin trouvé des asiles dans les pays alliés, en France notamment, et c'est ainsi que nos Petites-Dalles ont été désignées pour recevoir quelques-uns de ces infortunés qui y ont été l'objet de la sympathie et de la compassion que méritaient leur malheur et la dignité de leur attitude.
Il est vrai qu'il constitue une élite intellectuelle, puisque tous ou presque tous exerçaient dans leur pays des professions libérales. De ce refuge où leurs existences matérielles est assurées, ils peuvent aussi suivre avec confiance les événements qui préparent la résurrection de leur pays et plus particulièrement de son armée. On avait pu la croire irrévocablement détruite et voici que grâce aux alliés elle est debout, équipée, forte de 150.000 hommes, prête à combattre à côté des soldats de l'Entente, a renouvelé ses anciens exploits, à vaincre ou à mourir pour la délivrance de la patrie.
Il y a quelques jours, mon ami, M. Auguste Boppe, ministre de France auprès du gouvernement serbe installé à Corfou, m'écrivait :
« Vous avez appris de quelle admirable façon les Serbes se sont réunis à Corfou. Ceux qui les ont connus à Scutari ne pouvaient les reconnaître quand ils sont partis pour Salonique. Quels soldats admirables ! »
C'est pour vous, Messieurs les réfugiés, que j'ai cité ce fragment de lettres.
Il ranimerait vos espérances, votre foi dans l'avenir de votre pays si elle avait besoin d'être ranimée. Que du moins il contribue à cicatriser les plaies de vos âmes meurtries et les emplisse d'un légitime orgueil !
Je vous ai dit, Mesdames et Messieurs, que la vie matérielle de nos réfugiés était assurée, c'est-à-dire le nécessaire. Toutefois, ceux qui les approchent avaient cru s'apercevoir qu'il en était parmi eux de plus éprouvés que d'autres, à qui manquait un peu de ce superflu dont les habitudes d'une existence confortable font presque une nécessité.
De là, l'idée touchante dont l'honneur revient à M. le Sous-Préfet d'Yvetot et à Mme Piettre d'organiser cette réunion dont nos réfugiés seraient les protagonistes et dont le profit leur vaudrait un peu plus de bien-être. Mais quand on a sollicité leur concours en leur disant pourquoi, ils ont déclaré qu'il le donnerait avec joie, mais en témoignage de gratitude envers la France et au bénéfice de la Croix-Rouge française.
— Quant à nous, ont-ils dit, nous n'avons besoin de rien, les moins malheureux s'étant entendus entre eux pour venir en aide à ceux qui le sont davantage.
C'était un beau geste, Mesdames et Messieurs, un révélateur de ce que peut contenir de noblesse et de dignité l’âme des proscrits quand ils souffrent pour une grande cause. Il a bien fallu s'y soumettre.
— Soit, au bénéfice de la Croix-Rouge française, a-t-on répondu, mais aussi à celui de la Croix-Rouge serbe.
Voilà mes chers compatriotes, toute la genèse de la réunion d'aujourd'hui.
Elle ne me laisse rien à ajouter. Si j'étais ainsi à la table d'un festin, je lèverais mon verre à la résurrection victorieuse de la Serbie. Associez-vous à ce toast idéal en applaudissant au spectacle qui va vous être donné.
Ernest Daudet
Paris en décembre dernier
Impressions intimes d’un jeune homme expatrié
Impressions intimes d’un jeune homme expatrié
Je les dédie à toi, mon cher Bane, ces pages sincèrement écrites, à toi qui as su donner ta belle jeunesse à la patrie, que tu aimais en vrais patriotes.
C’était, dans une rue non loin du grand marché de Belgrade, une maison à deux étages, nouvellement construite, dont la façade, on rembrunie par le soleil qui l’inondait les clairs jours d’été et fatiguée de supporter cette chaleur, se résigner à regarder silencieusement les eaux agitées du Danube et l’immense plaine de Banat qui s’étend à perte de vue.
Dans la journée c’était par là le tapage de tout le monde qui va au marché pour vendre ou pour acheter. Le soir venu, le bruit cessait et la rue reprenait son aspect tranquille, interrompue de temps à autre, par le coassement des grenouilles venant du fleuve et cette musique endormait et réveillait les habitants de tout ce quartier.
Tous les soirs, est toujours à la même heure, la porte d’une chambre de l’appartement du premier de cette maison s’ouvrait et alors entraient des jeunes gens qui, à en juger par leur façon, y étaient chez eux ou avaient bien l’habitude d’y venir.
Le refuge de ces jeunes gens était bien modestement meublé : une table au milieu, quatre chaises autour, un divan à côté, l’étagère à livres contre le mur, quelques tableaux d’auteurs favoris accrochés par-ci, par-là, sans oublier les vrais amis de ces jeunes gens : la lampe à abat-jour, posée sur la table, mignonne et docile, et le poêle écossais, le bon compagnon des longues nuits d’hiver.
Le jeune homme auquel ce petit coin servait de cabinet de travail, avait comme les autres du reste, un culte d’amitié pour cet endroit qui avait tant entendu les raisonnements et les projets de ses visiteurs, riches en idée : celles-ci étaient nombreuses comme les rayons se dirigeant vers leurs jeunes visages du milieu de la lampe sous laquelle il venait s’abriter tous les soirs.
C’était à l’époque où ils préparaient leurs examens de baccalauréat.
Les belles nuits de mai, auxquelles Alfred de Musset doit ses plus belles poésies, douces et bourdonnantes d’une légère tristesse et pleines d’étoiles dont l’énigmatique frissonnement charmait le berger d’Alphonse Daudet qui en cherchait naïvement la cause, réveillaient chez les quatre jeunes hommes, courbés sur leurs livres, l’image de leur combinaison et de leurs rêves : Paris. Le Paris chevaleresque et noble de jadis et le Paris actif et intellectuel d’aujourd’hui ! Le Paris d’Alexandre Dumas père, et celui d’Anatole France !
Cela les faisait travailler plus énergiquement comme les examens approchaient.
Aucun des deux n’entendait, dans les vagues murmures du fleuve d’en bas, les avertissements fatals des événements proches, qui ont fait que les quatre jeunes hommes, les examens passés, au lieu d’aller réaliser leurs idées, se sont dispersé chacun de leur côté, pour servir de leur mieux la patrie en danger.
Il y avait un amour plus fort que celui de ce petit refuge, c’était l’amour de la patrie menacée, de la patrie ayant besoin de tous ses fils, pour résister à l’adversaire bien plus nombreux et beaucoup mieux préparé.
Le petit coin adorait et toutes ces choses, si étroitement liés à leur existence d’alors, ont été abandonnés et subitement, sans adieu, même sans un amical sourire.
Ne vous fâchez pas, pauvre mignonne chose, vous gardez le plus cher de ce qu’ils ont pu vous donner : leur belle jeunesse de 20 ans, souriante et fraîche. Gardez-la bien, ils viendront vous la demander un jour, telle qu’ils vous l’ont laissée. Gardez la bien, pauvres mignonnes choses.
A Marseille, au moment de monter dans le train qui devait m’amener à Paris, je me suis rappelé, — étant un de ces quatre jeunes hommes dont l’un, fils d’un de nos auteurs dramatiques les plus éminents, est tombé au champ d’honneur quelques jours avant le commencement de notre pèlerinage fatal, et dont les deux autres sont avec nous dans le pays dont la pensée obsédait leur tendre jeunesse, — je me suis rappelé, dis-je, ce récent passé beau et douloureux.
— Le lendemain matin de ce jour-là, dans un hôtel de la rue de Rivoli, je ravivais de nouveau les souvenirs de cette vie, jeune et attrayante, passée dans mon beau pays lointain et martyr.
Les rayons tachés du soleil et de décembre entraient anxieusement dans la chambre et s’amusaient à caresser le maigre visage du nouveau venu. C’était sa façon de souhaiter la bienvenue à ce jeune malheureux.
Je m’approchais de la fenêtre et je vis le soleil de Paris, un petit trou clair creusé dans le ciel nuageux, dont les faibles rayons paraissaient être les larmes d’une douleur silencieuse et discrète.
Une fois dans la rue, marchant du pas incertain de l’étranger dans la ville inconnue, j’ai éprouvé le même sentiment.
En regardant les femmes en deuil, dont les visages portaient des traces de souffrance, les hommes empressés les taciturnes, les maisons tristes et mornes, la rivière chantant quelque chose d’incompréhensible, qui faisait pleurer, je sentis la nostalgie : car j’ai vu dans les tristes visages de ces femmes et de ces hommes, les visages de nos mères et de nos soeurs, de nos pères et de nos frères laissés là-bas, dans le pays souffrant comme celui-ci ; dans ces maisons languissantes le reflet de nos foyers abandonnés, dans la Seine coulant doucement notre Save autrefois coquette, tranquille et taciturne ; dans le jardin du Luxembourg, ce rendez-vous de jeunesse, dont les arbres grelottaient de froid, notre Calimegdane qui en ce moment-là gémissait lui aussi dans sa jeunesse gaie et insouciante.
Mais dans cette atmosphère où tout était en deuil, où tout peut régler mort pour ce géant de Paris et le beau pays de France, il y avait de l’énergie et de la persistance.
Je ressentis un amour de cet endroit, analogue à celui du pays qui cache ce qui m’est le plus cher ; je sentis que je l’aimais et que je l’aimerai.
En rentrant à l’hôtel, j’ai caressé amicalement des yeux les eaux de la Seine et regardé tendrement de la terrasse du parc des Tuileries, le petit soleil de Paris qui attendait patiemment le jour où ses vifs rayons nous annonceront brillamment la victoire.
— J’ai compris la France, je l’aimais et je l’aime toujours plus chaque jour.
Radovane Petrovitch
Discours de M. Wladislav Petkovitch
Traduit en français et lu par M. Bora Martinatz, étudiant en droit.
Mesdames, Messieurs,
Je vous prie d’être ce que vous êtes toujours : indulgents envers les faibles, bienveillants envers ceux qui n’ont pas d’expérience. Si je commets des fautes dans ma causerie, ce ne sera pas la peine de me corriger, le temps le fera. Car je suis le fils, l’humble fils de ce peuple, qui est embrassé par l’héroïsme et la douleur. Je suis le fils faible de mon peuple et les faibles peuvent devenir forts seulement avec le temps.
Je vous prie de me permettre de vous remercier et comme Serbe et comme membre de la présente Colonie, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous ferez pour nous. Et si je n’y réussissais pas non plus, j’en assume sur moi toute la responsabilité et c’est seulement à moi que vous devrez adresser vos reproches.
Excusez-moi, Messieurs, de me présenter si embarrassé aujourd’hui devant vous, et ne vous étonnez pas si je suis plutôt triste que sérieux.
Si je lève parfois la tête, je vous en prie, comprenez-moi ; ce ne sera pas de gaîté, mais de fierté, de fierté d’être chez vous, d’être avec vous. Car le temps de mon bonheur est disparu avec la liberté du peuple Serbe. Nous sommes sans patrie.
Et maintenant, Messieurs, si cela vous plaît, je vous invite à repasser avec moi quelques pages de l’histoire du peuple Serbe, histoire qui n’est pas encore finie et qui n’a pas encore son nom.
Le 5 octobre 1915, l’année dernière, en Serbie, n’a pas été un jour comme les autres. Sitôt le soleil couché, un infernal tonnerre s’entendait quoique la soirée fut calme et le ciel serein. C’était le salut que les deux mille canons de Mackensen adressaient au soleil couchant. Et l’orgie sanglante commençait.
Cinquante-deux heures sans cesser les canons ont tonné. Dans les villes et les villages, aux environs, les fenêtres ont tremblé pendant deux nuits et demie et les enfants ont pleuré.
Et quand il sembla au généralissime teuton que la première partie de son programme sanguinaire était réalisée et que le terrain était nettoyé, la troisième nuit, vers minuit, il commença à jeter par-dessus le Danube ses troupes.
Mais comme il a été surpris ! Dans ce fracas et le tonnerre, le ciel était resté calme, le bleu Danube était resté calme ; mais le soldat serbe étaie resté calme aussi : il se taisait et attendait tranquillement dans sa tranchée. J’ai été alors sur le Danube, vers la ville de Pozarevatz, comme correspondant militaire. J’ai toujours connu notre soldat, ce qu’il est avant le combat et ce qu’il est pendant le combat.
Cette fois-ci, comme d’habitude avant le combat, il était calme ; il n’avait pas peur de l’Allemand, quoiqu’il le sût redoutable.
Au contraire, il était gai d’avoir l’occasion de l’affronter : « Combattons jusqu’au bout et advienne ce que pourra ! » Et voilà comment ils se sont rencontrés avec les Boches.
Quand la nuit du 7 octobre sur Doubravitza (l’endroit qui se trouve au bord du Danube), les quatre bataillons du Vardar on fait en seize heures sept attaques et jeter les Allemands dans le Danube. Et au premier crépuscule, il ne restait aucun Allemand près de Doubravitza, mais il ne restait aucun Serbe non plus.
De pareilles luttes ont obligé Mackensen à demander le septième jour de son offensive des secours, si les Bulgares n’attaquaient pas immédiatement la Serbie.
Et le félon a voulu rester toujours fidèle à la félonie et la Bulgarie nous attaqua le 17 octobre.
Et il arriva ainsi que la surprise qui était tombée sur la tête de Pathoren, généralissime préféré de François-Joseph, évita Mackensen à qui le soldat serbe pourtant préparait aussi de grandes surprises. Et lui, le soldat serbe, qui a porté toujours la couronne de la victoire sur sa tête fière, a reçu en pleine poitrine des défaites si grandes et de si grands malheurs, que jamais jusqu’à présent ni l’homme ni Dieu n’en ont vu de semblables.
Arrêtons-nous ici.
Pendant quatre jours, jusqu’au 17 octobre, les troupes qui étaient sur le Danube ignoraient leurs nouveaux ennemis. Les combats avaient déjà eu lieu sur notre territoire, et quoique les troupes fussent en petit nombre, ils résistaient tout de même à l’ennemi.
Mais le cinquième jour, toutes les troupes apprirent la nouvelle non seulement de l’attaque bulgare, mais aussi de la chute d’Uscub, Vranjé et d’autres villes. La débâcle nous survolait ; on battait en retraite ; les luttes contre les Allemands avaient cessé, le terrain se perdait, morceau après morceau, comme dans un déluge. Et chaque jour les malheurs augmentaient. L’enfer descendait sur la terre et le peuple Serbe y descendait de plus en plus, et quand on arriva à Durazzo, le calice était vidé jusqu’à la lie.
Et voilà maintenant quelques images qui sont restées vivantes dans ma mémoire, de cette tragique retraite :
Nous voilà à la montagne de Merdare. Nous n’avons aucun secours, aucune ambulance.
C’était la nuit, il faisait froid, il faisait du brouillard. Le capitaine était assis, la tête dans les mains, et les soldats dispersés. Tout d’un coup un soldat l’aborda : « Capitaine, je ne peux plus me battre ». « Pourquoi » ? Lui demanda l’officier en levant la tête. « Si j’étais sur de tomber mort, cela irait bien ! Mais si j’étais blessé, alors quoi ? Vous n’ordonnerez sûrement pas qu’on me tue ; du reste personne ne voudra me tuer », ajouta le soldat comme réfléchissant en lui-même. Tous se taisent. L’officier, la tête levée haut, regarde non le soldat, mais vers quelque part au loin dans la profonde nuit qui était déjà tombée sur la Serbie.
Nous voilà à Kossovo. Les équipages militaires, traînés par les boeufs, marchent encore. Où ? Les troupes fatiguées et épuisées marchent encore. Mais où ?
Nous voyons quelques garçons de 15-18 ans retournant dans leurs foyers que l’ennemi a déjà occupés. Ils retournent tiraillés par la faim. Ils sont allés quelque part, n’importe où, en avant, pour ne pas tomber seulement aux mains de l’ennemi, et maintenant ils retournent. Les voilà qu’ils abandonnent en ce moment la route et marche à travers une prairie, leurs doigts dans la bouche. Tout cela nous paraît ordinaire. Mais tout d’un coup, on voit le fleuve Lab comme se remuer : les garçons y disparurent, l’eau les avait engloutis. « Ah ! » criaient les uns. « Ah ! mon Dieu ! » criaient les autres. Mais s’ils nous avaient demandé un morceau de pain ! Et les boeufs, les têtes courbées sous les jougs, traînaient les chariots au bruit grinçant des roues.
Nous voilà à Zljeb, aux portes du Monténégro, ce pays qui n’est couvert que par des roches. On traverse encore des montagnes par des chemins de chèvres. Deux garçons y marchent. Le jeune, âgé de 14 ans au plus, mène un cheval. L’aîné, âgé de 16 ans environ, tenait une femme montée sur le cheval est liée à la selle. Ces garçons, ce sont ses fils. Leur mère ne peut plus marcher. Est-elle fatiguée ? Non ! non ! Elle n’est pas fatiguée, elle est morte, morte en route. Les enfants la mènent jusqu’au premier village ou plutôt jusqu’au premier morceau de terre pour l’y ensevelir.
Plus loin, dans un creux des roches, était assis un soldat serbe. Son visage était si convulsé qu’on eût dit qu’il était déjà une fois dans le tombeau. Sa bouche était ouverte. Dans la main gauche il serrait quelque chose de noir. Est-ce un morceau de terre ? Je m’approche davantage. Tiens ! du chocolat. Quelqu’un qui avait encore un peu de coeur lui a donné par pitié ce morceau de chocolat, au dernier moment. Mais trop tard ! L’éternité séparait déjà sa main de sa bouche.
Nous sommes à Scutari. Dans une rue, quatre soldats marchent, leur visage est noir de poussière, on dirait quatre fantômes. Chacun d’eux porte un morceau de pain blanc, ils le portent aussi tendrement qu’une mère qui porte son enfant. J’arrêtais l’un d’eux : « Est-ce que tu vends du pain mon vieux ? » Il me regarda d’abord doucement et puis ajouta : « Non, Monsieur, je ne le vends pas, il y a un mois que je n’en ai pas vu et maintenant le vendre. Ah ! Non ! Je l’ai embrassé sept fois, Monsieur, et je l’embrasserai encore ». Pieusement il le porta à sa bouche et l’embrassa.
Mes yeux se remplirent de larmes. Il me regarda de nouveau et je sentis que quelqu’un me bénissait.
Voilà encore un exemple, vous l’avez ici devant vos yeux : c’est notre souverain, notre bon roi Pierre, qui a traversé toute l’Albanie en chariot de boeufs.
Mais, assez ! Mesdames, Messieurs. Laissons l’Albanie et le Monténégro, laissons la Serbie qui repose à l’ombre des tristes saules, et ajoutons encore quelques mots. A la fin de l’année dernière et au commencement de cette année, les bateaux, les uns après les autres, atteignaient les côtes françaises. Ils apportaient avec eux les impuissants débris du libre peuple Serbe. Mais ces impuissants débris se remirent promptement devant le coeur français qui battait si ardemment pour nous ; devant l’âme française qui nous réchauffait par sa bonté et sa bienveillance, par toute sa bonté et toute sa bienveillance.
Et ainsi le sort a donné à la France, pays de liberté, un nouveau rôle : celui de recevoir chez elle un peuple qui est tombé pour la liberté, mais qui par la victoire de la France, de la Russie et de l’Angleterre, la conquerra de nouveau. Et vous, Français, vous nous avez ouvert largement vos portes. Nous étions abattus, vous nous avez remontés. Nous étions dans le désespoir, vous nous l’avez écarté. Nous avions perdu la foi et en l’homme et en Dieu ; chez vous, nous l’avons retrouvée.
Dans votre complaisance, vous n’aviez pas de limites, si ce n’est seulement la question d’améliorer notre sort. Les meilleurs exemples en sont les colonies Serbes qui se sont dispersées dans toute la France.
Mais je ne veux pas abuser plus de votre attention, aussi ne vous parlerai-je pas de cette Colonie aux Petites-Dalles et ne vous dirai-je pas à quel point nous nous y trouvons bien !
Mais je dois mentionner que vous nous avez permis de donner ce concert, que vous nous avez permis ce dont vous vous privez vous-même.
Je dois dire aussi que la couronne de tout cela, c’est la présidence de M. le préfet de Rouen qui, malheureusement empêché d’y assister personnellement, est remplacé aujourd’hui par l’honorable M. Piettre, sous-préfet d’Yvetot.
De même, l’honneur de tout cela c’est la présence de M. Ernest Daudet, le digne frère de son illustre frère, qui préside aussi le concours particulier à ce concert.
Remercions aussi tous ceux qui ont bien voulu nous prêter leur gracieux concours. Tout cela, c’est la grâce et la musique.
Merci à tous ceux qui ont voulu nous faire l’honneur de leur présence. Merci à tous !
Mesdames, Messieurs,
Quand le grand jour sera venu pour nous de retourner dans notre patrie, nous quitterons la France, cet asile de repos et d'espoir.
Je vous en prie : gardez un bon souvenir de nous, car nous vous avons aimés, même alors que nous avons douté. Nous vous avons aimés, nous vous aimons, nous vous aimerons toujours, toujours.
Et demain, quand nous serons rentrés dans nos foyers, si nos mères sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont : « Comment étiez-vous en France? » Nous leur répondrons : « Nous y étions bien ». Si nos femmes et nos soeurs sont encore en vie, elles nous accueilleront et nous demanderont « Comment étiez-vous eu France ? » Nous leur répondrons « Nous y étions bien ». Si nos enfants, qui ont connu les plus grandes épreuves de ce monde, sont encore en vie, ils nous accueilleront aussi, mais leur bouche ne saura pas nous poser cette question ; ils nous demanderont tout simplement « Où et donc cette France ? ».
Au lieu de leur répondre, nous mettrons la main sur notre coeur et nous leur dirons : « Voilà, la France est ici ! », et nos enfants nous comprendront bien.
Mesdames, Messieurs, vive la France !
Wladislav Petkovitch
Historique de la Colonie
Compte-rendu du concert
Compte-rendu du concert
Venir en France et la connaître, c’était le rêve de nous tous. Et ce qui n’était pas possible à beaucoup d’entre nous pendant la paix, nous est destiné pendant la guerre, au moment de nos plus grands malheurs nationaux et particuliers.
Pour l’avenir de nos familles restées dans nos maisons, avec nos biens, nous partîmes nombreux pour fuir l’invasion, loin de l’ennemi commun ; mais arriver en France ceux d’entre nous, seulement, qui eurent la chance de résister aux souffrances de toutes sortes : faim, froid, fatigue, endurées en Albanie, et ceux qui purent se défendre des attaques des Albanais.
Nous sommes maintenant dispersés par groupes plus ou moins nombreux dans différents points de la France, notre seconde patrie, où nous sommes reçus aussi bien qu’il est possible de l’être et il est bien certain que nous ici, aux Petites-Dalles, le somme mieux encore que partout ailleurs.
Ce qu’on fait pour nous et la façon dont le font Monsieur le Sous-Préfet d’Yvetot et madame Piettre, représentants du Gouvernement Français, ainsi que Monsieur Certain, maire de Sassetot, nous obligent pour toute notre vie et nous ne les oublierons jamais.
La générosité du peuple français sera racontée, chez nous, de génération en génération.
Les premiers réfugiés serbes sont arrivés dans cette colonie, aux Grandes-Dalles, le 27 janvier 1916 (n. s.), le jour de Saint-Sava Serbe et, de ce jour jusqu’à aujourd’hui, nous fûmes 133. Aujourd’hui, la colonie compte 83 personnes, dont 23 dames et 60 messieurs.
La colonie a déménagé des Grandes-Dalles aux Petites-Dalles le 23 mai 1916, installée à l’hôtel des Pavillons et à la villa Kermor, d’une façon telle que l’on ne croirait pas à une colonie de réfugiés. Accueillis chaque jour comme de bon et vieux amis, nous avons pu nous ressaisir et préparer un concert au profit de la Croix-Rouge Française et Serbe.
Le concert qui a eu lieu le 24 août, à 3 heures, a eu un tel succès qu’il a dû être redonné le même soir à 9 heures. La recette totale des deux concerts et de 1.384,80 fr., dont une somme de 1000 fr. est remise à Monsieur Piettre pour envoyer 500 fr. au général Sarrail, à Salonique, pour la Croix-Rouge Serbe et 500 fr. pour la Croix-Rouge Française à Yvetot.
A cette occasion, au nom des membres de la colonie, je remercie tous les auditeurs et plus particulièrement M. Ernest Daudet pour son intéressante causerie pour laquelle cette brochure est imprimée, ainsi que les autres personnes qui ont pris part au concert, notamment Mademoiselle Piettre qui en a organisé une grande partie et a fait beaucoup pour son succès, ainsi que Mesdemoislles Giron, Nicole Anckier, Duval, Leroyer, Monsieur Francin, Mesdemoiselles Schaeffer, Bredaut qui ont bien voulu prêter leur concours.
De même, au nom des membres de la colonie, je remercie Monsieur le Préfet de la Seine-Inférieure et Madame Morain qui ne nous oublient pas quoique n’étant pas tout près de nous, Monsieur le Sous-Préfet d’Yvetot, Madame et Mademoiselle Piettre, qui viennent nous voir journellement et font pour nous tout ce qui est possible de faire, Monsieur et Madame Certain, Monsieur Bourdon, qui s’occupent de la colonie et s’empressent toujours pour nous être agréables.
Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion sans remercier :
M. Alfred Morain, Préfet de la Seine-Inférieure ; Madame et M. Piettre, Sous-Préfet Yvetot ; M. H.-O. Beatty, directeur général de l’American Relief Clearing Hause (5, rue François-Ier, à Paris) ; M. Lepicard, maire de Canouville ; M. Leconte, représentant de la Bénédictine de Fécamp ; M. Pesquet, percepteur à Lillebonne ; Mme Greulich ; M. Cochaux, de Paris, dont les dons en argent comptant font une somme de 700 francs, qui est distribuée aux réfugiés de la Colonie les plus nécessiteux par M. Certain, maire, ou par le directeur de la Colonie.
L’American Relief Clearing Hause et son directeur général M. H.-O. Beatty, par l’intermédiaire duquel nous recevons des nobles Américains des dons en vêtements, linge, chaussures, etc., pour dames, messieurs et enfants, et dont, par Madame Piettre, nous avons, jusqu’à présent, reçu 2.393 articles, distribué 1.830 articles ; il reste à distribuer encore 563.
M. Bourdon, le directeur d’Ecole ; Mlle S. Dutot, directrice d’Ecole ; Mlle Fautrat, institutrice ; Mlle A. Delettre, institutrice, qui, pendant plusieurs mois, ont donné des leçons de français aux membres de la colonie.
Les rédactions du Temps, du Journal des Débats, du Figaro, du Matin, du Journal, de l’Illustration, des Annales Politiques et Littéraires, de la Femme chez elle, qui envoient régulièrement leurs journaux gratuitement.
Les éditeurs de musique : MM. Heugel, Choudens, Max Eschig, Marcel Labbé, Enoch et Cie, qui ont envoyé des partitions.
Vive la Serbie, notre Patrie !
Vive la France, notre seconde patrie !
D. Pavlovitch
Haut de page